J'ai dernièrement eu l'occasion de tester différents mascaras dont je vais m'efforcer de parler au mieux :
- le mascara parfait pour les yeux sensibles : le lash-power mascara de Clinique. Coûtant 23e (soit un peu moins qu'un mascara de grande marque classique) il ne jouit, le pauvre, que d'un tube absolument affreux. Il travaille la longueur tout en naturel. On sent bien sa texture strech, mais au final, on ne voit pas qu'on porte du mascara. Le regard est souligné, les cils réellement allongés et légèrement étoffés, mais dans un naturel rarement égalé. Quand on a les yeux irrités, sa texture n'agresse pas du tout. Il convient surtout aux jeunes femmes que les démaquillants irritent : en effet, il se dissout dans l'eau chaude. Il faut qu'elle soit très tiède : des larmes de crocodile ne le font pas fondre. En revanche, il est un peu fastidieux à ôter : l'eau l'effrite et il faut attendre de bien l'avoir enlevé. En somme, c'est un mascara idéal pour les yeux fragiles, ou celles qui aiment se démaquiller sous la douche.
- le brushing de cil : avec le Diorshow 360, qui coûte très cher (35 à 40e). C'est l'ultime gadget make-up : un mascara dont la brosse tourne toute seule (dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour permettre de maquiller les cils du haut, du bas et des deux yeux). Je n'aime pas les mascaras Dior et celui-ci n'y coupe pas. Texture pâteuse, la brosse automatique me déçoit : elle n'apporte rien de bien extraordinaire, ni en volume ni en longueur. Elle est pas mal pour souligner les cils du bas qu'elle recourbe un petit peu (comme ils sont fins et légers) mais est insuffisante pour les cils du haut. C'est vraiment, à mon sens, de l'argent gaspillé.
- l'effet travaillé : le Volume Effet Faux-Cils Shocking YSL (28e50). Je salue particulièrement les couleurs : déclinées autour de noirs légèrement teintés (noir jade, noir cendre, noir bronze, noir burlat, noir abysses) elles offrent des reflets discrets qui illuminent et colorent le regard tout en subtilité. Comme son grand-frère l'Effet Faux Cils, il a une texture très épaisse, et même encore plus crémeuse. Quand la brosse sort du tube, on se demande qu'en faire, et il faut quelques applications pour ne pas en mettre partout ailleurs que sur les cils. Contrairement à l'Effet Faux Cils, il offre un vrai effet travaillé. Il étoffe considérablement le volume, la longueur, et épaissit les cils. "L'ennui", c'est qu'il donne un regard très maquillé, et ne conviendra pas à celles qui souhaitent quelque chose de plus délicat. Je pense que comme son grand-frère il sèche vite en revanche. A confirmer.
- le mascara aux mille lumières : Volume Million de Cils Luminizer de l'Oréal (environ 17e). Lumière, lumière, je te cherche dans ce mascara. En effet, au démaquillage, on voit bien qu'il y a plein de petites paillettes, mais elles ne se voient pas sur les cils, même pas jeu de lumière. L'option "luminizer" n'apporte donc rien. En revanche, Million de Cils est un super mascara, malgré une texture un peu sèche qui peut gratter les yeux. La brosse à picots en plastique est très facile à utiliser et permet vraiment d'éviter les paquets. Le mascara n'allonge pas vraiment, mais il recourbe un petit peu les cils et leur donne un bel effet frangé. D'autant qu'il semble vraiment les démultiplier sans effet épaissi comme chez YSL.
"MON CIRQUE SE JOUE DANS LE CIEL, IL SE JOUE DANS LES NUAGES PARMI LES CHAISES, IL SE JOUE DANS LA FENÊTRE OÙ SE REFLÈTE LA LUMIÈRE" MARC CHAGALL
mercredi 28 décembre 2011
Eyes Lips Face (E.L.F) Eye-Liner Crème et Pigments pour les Yeux
J'ai cédé... et j'ai commandé.
Tout d'abord, les Eye-Liners Crème (4 euros). Je les ai commandés en "gunmetal" et en "ivory". Les deux rendent très différemment, si bien qu'on dirait des produits différents. Avant tout, je dois souligner que le packaging en petite boite carrée transparente à bouchon noir est très sympa. L'eyeliner arrive ainsi avec un petit pinceau : cela donne quelque chose d'assez classe, ce qui est toujours un plus pour un produit "cheap".
La texture n'est pas très crémeuse : on dirait en fait plus une ombre à paupière qui aurait pris l'eau. Ce compact est d'ailleurs assez difficile pour se saisir du produit sur le pinceau. D'ailleurs l'application est délicate : soit cela marque trop, soit cela ne prend pas, ou alors le produit s'effrite. Avec un peu de patience (et c'est beaucoup plus facile de tracer le trait sur une ombre à paupière) on arrive cependant à un joli résultat. Pour ma part, je dois quand même passer par l'utilisation d'un autre pinceau.
Le version ivoire prend beaucoup facilement que la version gunmetal sur la paupière. J'étais un peu dubitative sur mon choix de couleur. Sur une ombre à paupière grise, c'est assez original, et ça donne un regard frais.
Tout d'abord, les Eye-Liners Crème (4 euros). Je les ai commandés en "gunmetal" et en "ivory". Les deux rendent très différemment, si bien qu'on dirait des produits différents. Avant tout, je dois souligner que le packaging en petite boite carrée transparente à bouchon noir est très sympa. L'eyeliner arrive ainsi avec un petit pinceau : cela donne quelque chose d'assez classe, ce qui est toujours un plus pour un produit "cheap".
La texture n'est pas très crémeuse : on dirait en fait plus une ombre à paupière qui aurait pris l'eau. Ce compact est d'ailleurs assez difficile pour se saisir du produit sur le pinceau. D'ailleurs l'application est délicate : soit cela marque trop, soit cela ne prend pas, ou alors le produit s'effrite. Avec un peu de patience (et c'est beaucoup plus facile de tracer le trait sur une ombre à paupière) on arrive cependant à un joli résultat. Pour ma part, je dois quand même passer par l'utilisation d'un autre pinceau.
Le version ivoire prend beaucoup facilement que la version gunmetal sur la paupière. J'étais un peu dubitative sur mon choix de couleur. Sur une ombre à paupière grise, c'est assez original, et ça donne un regard frais.
J'ai aussi tenté les pigments (4 euros également). J'avais peur qu'ils ne ressemblent trop aux ombres à paupières minérales qui m'avaient beaucoup déçue sur la tenue, la texture trop pailletée, et rien que sur l'insupportable tamis. J'ai été agréablement surprise. Déjà, le packaging, commun à celui de l'eyeliner crème est bien plus agréable que celui des ombres minérales. Cela fonctionne également sur un système de tamis, mais beaucoup plus efficace que celui de la gamme minérale. C'est sûrement à mettre au compte de la texture plus épaisse de la poudre à paupière. J'ai opté pour la couleur "Breezy Blue", qui est un bleu-gris foncé légèrement scintillant (mais pas du tout pailleté contrairement à ce que semble indiquer l'image contractuelle). Le produit est assez épais, ce qui, si on l'utilise avec parcimonie, rend l'application relativement aisée à travailler au pinceau. L'intensité de la couleur est vraiment impeccable, et c'est un avantage certain sur le produit concurrent chez l'Oréal, Color Infaillible.
Libellés :
E.L.F,
Eyeliner crème,
eyes lips face,
Futilités Dermatologiques,
Maquillage,
Pigments
Routine de teint !
La base de tout maquillage, c'est bien évidemment le teint. Si on se maquille les yeux avec de l'ombre, il se doit d'être véritablement impeccable, sous réserve de quoi il apparaîtra encore plus imparfait que ce qu'il n'est réellement.
Personnellement, je n'ai pas vraiment une mauvaise peau. Quelques irrégularités et des sillons d'expression très marqués. Par période, ma peau fait des sortes de petits granulés qui la rendent irrégulière, et j'ai parfois quelques rougeurs sur le haut des pommettes, mais pas de problème de brillance, de boutons ou de pores apparents. En soi, ma routine teint consiste plus à corriger ma couleur que l'aspect de ma peau en lui-même. En revanche, j'ai la peau très sèche, voire qui pèle sur la zone T (je suis faite à l'envers) et ça, ça ne pardonne pas.
Evidemment, avant toute chose, il convient de bien se nettoyer. La peau produit beaucoup de toxines la nuit afin de se reconstituer. Il faut donc ôter ce voile impur. Idéalement, il faudrait utiliser une mousse nettoyante (j'ai rencontré une conseillère Shiseido qui m'a bien expliqué qu'il ne faut en aucun cas utiliser des mousses désincrustantes : elles agressent la peau et la rendent plus productive de sébum). Grande feignante, je me contente d'un coton de lotion.
J'utilise une lotion LCBio qu'on peut trouver en institut : l'eau des champs au coquelicot, qui coûte 23e40. Je l'aime bien car elle est fraîche et depuis que je l'utilise, je constate que j'ai meilleure mine. Néanmoins, l'odeur de coquelicot me gêne. J'aime bien l'idée que ce soit un produit naturel, et dans l'ensemble tous les produits de cette marque me plaisent.
 |
| Eau des Champs au Coquelicot, LCbio 23e40 environ, photo empruntée au blog http://beaute-vanite.blogspot.com |
Après, il faut bien évidemment s'hydrater : c'est une étape majeure, surtout pour une peau comme la mienne qui risque de peler sous le fond de teint (et il n'y a rien de pire). J'utilise, le matin, la crème Hydrazen de Lancôme. Elle convient bien à ma peau sensible le matin, mais n'a pas une hydratation suffisante (mais en version peau sèche) pour que je l'utilise également le soir. Elle est relativement chère (environ 53e) mais elle s'étale facilement. Ainsi, une pointe suffit. Elle donne un aspect un peu brillant à la peau, bien qu'elle ne la graisse pas cependant. J'ai les yeux sujets aux poches et aux cernes, surtout le matin. J'ai essayé environ tous les produits possibles, et pour le moment, le mieux que j'ai trouvé est l'Hydrazen Neurocalm de Lancôme sur lequel j'écrirai postérieurement.
Arrive l'étape maquillage à proprement parlé. Trois chemins s'offrent alors : un simple peu de poudre, une crème hydratante teintée ou du fond de teint. Au quotidien, j'opte le plus souvent pour les deux premières solutions.
Un voile de poudre permet d'unifier le teint et de donner un meilleur fini à la peau. Mais même avec une belle peau il n'est pas forcément suffisant quand on utilise des couleurs, surtout foncées, sur les yeux.
 |
| Crème de soin teintée Clarins, env 30e |
La crème hydratante teintée est une très bonne alternative : elle donne bonne mine tout en assurant un confort non-négligeable et floûte plutôt bien les imperfections. J'utilise la crème de soin teintée de Clarins. Elle coûte 30 euros, ce qui peut paraître onéreux. Néanmoins, il faut en mettre très peu. Elle peut effrayer car la couleur à la sortie du tube est foncée même sur les teintes les plus claires. Mais elle se fond très bien sur la peau, et si la teinte est bien choisie, ne fait pas du tout effet "tombée dans le pot d'autobronzant". Elle donne un joli fini à la peau, dont on sent bien que l'élasticité est travaillée. Au final, le rendu est très naturel et le teint rehaussé, plus pimpant. Le seul bémol, en dehors du prix, c'est l'odeur : elle sent les plantes (les produits Clarins sont travaillés d'après des extraits de plante). Attention : ce n'est pas parce que c'est une crème qu'il ne faut pas prendre le temps de se démaquiller le soir. La crème, comme la poudre, comme la simple pollution et comme bien évidemment le fond de teint, obstrue les pores. Sans un nettoyage quotidien avant de dormir, la peau ternit et étouffe. Selon les jours, j'utilise tout de même un anti-cerne sous la crème Clarins que je camoufle en passant la crème sur les yeux.
 |
| Base de teint Body Shop - 16e |
L'autre option ouverte est l'option tout combat : le fond de teint. C'est ma "routine" des jours où ça ne va pas du tout, des jours (soirs) où j'ai décidé d'être très maquillée, bref : du pas quotidien. Du coup, je tiens à bien le faire. Un fond de teint sans base de teint au préalable tiendra mal, et rendra mal. Il ne faut pas voir la base de teint comme "une couche en plus", mais comme un outil de naturel. Elle floûte vos imperfections, rides, ridules, et permet au fond de teint d'accrocher uniformément sans s'échapper au fil de la journée dans les commissures (créant ainsi l'effet plâtre). Il en existe plusieurs : certaines sont neutres et conviennent ainsi à toutes les peaux, d'autres ciblent un problème particulier (rougeurs, pores...). Make-Up Forever propose la gamme la plus large de bases. Personnellement, j'utilise une base Body Shop que je trouve très bien, et qui est raisonnable (16e). J'ai eu l'occasion de tester une fois une base La Prairie, et clairement, cette dernière rendait ma peau bien plus belle, avant même le fond de teint. Mais à 80e le petit pot, on se contentera de Body Shop et de sa base de teint matifiante à 16e.
 |
| MUFE HD Concealer - environ 24e |
L'étape inévitable, c'est l'anticerne. Chez moi, les poches sont marquées (et les éclairer permet de les faire oublier par effet d'optique) et en plus sombres. Le meilleur anticerne que j'ai trouvé pour le moment est un Make-Up Forever, très épais (comme leurs fonds de teint) mais qui ne plâtre pas du tout le teint (comme leurs fonds de teint aussi), le HD High Definition Concealer. Il coûte 24e50, ce qui le place très bien dans les produits de haute-parfumerie. Alors qu'il couvre bien, il a vraiment un rendu invisible. Choisi dans une teinte bien adapté, il peut même se passer de poudre dessus pour cacher le raccord. En revanche, il opère moins bien la fonction enlumineur (puisqu'il est là pour couvrir), pour laquelle il vaut mieux alors acheter un produit dans le genre Touche Eclat d'YSL, que personnellement je n'aime pas. Dans ce domaine, je préfère largement le Teint Miracle Lancôme. J'ai aussi trouvé un petit quatuor Sephora à 12 euros vraiment très bien (mais pour corriger les imperfections plus que pour corriger mes cernes récalcitrants).
J'ai alors plusieurs fonds de teint qui présentent tous des aspects différents :
- le Gemey Maybelline Dream Mat Mousse, qui donne un joli fini poudré. Il a une texture mousse assez agréable, avec un côté vraiment poudré sur la peau. Il faut le travailler aux doigts pour bien l'étaler, et il n'y a pas besoin de beaucoup de produit. L'ennui quand on a la peau sèche, c'est qu'il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas faire ressortir l'aspect sec et pelé de la peau. Il est je pense très bien pour les peaux mixtes à grasse, mais à déconseiller aux peaux sèches. Dans l'ensemble, son fini très poudré le rend assez figé : tout dépend de l'effet que vous recherchez. Il n'est pas très lumineux mais offre un teint parfaitement mat et uni (environ 17e)
- le Teint Innocence Compact de Chanel : c'est un des rares que j'ai trouvé qui m'offre exactement ma couleur de peau avec Pétale, qui est clair, mais ne tire pas sur le rose ou sur le jaune. Il est compact (à appliquer à l'éponge), mais un peu gras dans la texture, ce qui le rend très agréable à l'application. Il ne pose pas le problème du Dream Mat Mousse d'accentuer la sécheresse de la peau, et il offre un très joli fini, naturel et lumineux, relativement mat. Il tient très bien dans la journée, mais il faut le fixer avec une poudre pour lui donner un effet naturel. En tout cas, il est très facile à appliquer (environ 47e la première boite, puis 34e la recharge).
- L'Infinité Hydration Calvin Klein : Introuvable en magasins spécialisés, il est très souvent dans des ventes privées ou des magasins de dégriffe Make-Up, où on le trouve pour environ 12e. Le packaging est sympa, et le produit assez gras. Ce n'est pas un problème pour ma peau sèche, mais il faut vraiment le matifier avec une poudre pour ne pas ressembler à une frite à la sortie d'un bac Qwick. D'ailleurs dans le flacon, il a tendance à se scinder entre la partie huileuse et la partie solide. Il faut donc le secouer régulièrement pour ne pas avoir l'impression d'avoir un produit chimique non-identifié abandonné dans la salle de bain. La gamme de couleurs est assez sympa, et pour le prix, il est vraiment de bonne qualité. A conseiller donc aux peaux sèches pour environ 12e.
- Le Teint Idole de Lancôme : un fond de teint fluide sur lequel je n'ai rien à redire. Agréablement à porter, confortable, qui tient parfaitement toute la journée, il a un beau fini parfaitement naturel (environ 40e).
- Le Perfect Touch Radiance d'Yves St-Laurent : Mention spéciale au packaging pinceau intégré. J'avais peur que ce soit un peu gadget, mais le pinceau est très bien (même si le débit est assez fort : il faut donc verser sur la main et prendre avec le pinceau, il ne fonctionne pas comme un Touche Eclat où le produit monte dans les poils du pinceau). Il a une texture très légère et très fluide, mais offre une belle couvrance. Une large gamme de couleurs est offerte : elles se détachent des couleurs réelles de peau, mais elles ont un joli éclat qui donne vraiment bonne mine et bonne couleur. Un peu plus cher (40e environ) c'est vraiment le genre de produits qu'on pourrait utiliser tous les jours.
Pour un joli fini, il faut fixer le tout avec une poudre. Celle-ci doit être appliquée légèrement, en mouvements circulaires, de l'extérieur vers l'intérieur afin de ne pas perturber les petits poils du duvet des joues. Jusqu'ici, j'utilisais une poudre Sephora très bien, mais je vais bientôt en tenter une autre sur laquelle je reviendrai.
jeudi 20 octobre 2011
(The Artist) (Michel Hazanavicius)
On a fait beaucoup de bruit autour de The Artist dont il faut convenir que la recette était osée. Réaliser un film muet pour se moquer en apparence du muet, mais qui en fait, par son existence même qui capte le spectateur réhabilite le muet, c'est tout un imbroglio difficile à expliquer !
Mais c'est la première des qualités de Michel Hazanavicius dans sa réalisation. A aucun moment il ne défend le muet. Pas d'argument, pas de démonstration scénaristique. Rien d'autre que la preuve par elle-même : faire regarder 1h30 de film en noir et blanc sans aucune parole (et seulement deux scènes de 10 secondes de bruitage) ni aucun son autre que la musique à des spectateurs des années 2000 habitués au dolby-surround, à la HD et même au 3D. C'est l'humilité même du raisonnement qui lui donne toute sa puissance.
L'histoire est simple: déchéance d'une star du muet à l'avènement du parlant, remplacé par une nouvelle génération d'acteurs. Morale de l'histoire : le muet n'est pas complètement mort puisque c'est lui qui raconte le succès du parlant.
En revanche, un véritable univers se dégage : on retrouve le cadre du Hollywood que tous les films de et sur son âge d'or ont inscrit dans notre imaginaire collectif (on retrouve d'ailleurs des décors communs au Dernier Nabab avec Robert de Niro) et le cadre général des années 30 américaines, grâce notamment à la reprise des techniques d'image de l'époque : maquillage, types de plan entrés dans notre inconscient (contreplongée sur le côté sur le visage féminin tourmenté, fameux plan de la personne dans la voiture qui espionne, scène de folie avec les ombres...).
Le film reprend tous les codes cinématographiques de l'époque... et les acteurs en font de même. Cela met une double difficulté à leur charge : travailler l'expression pour qu'elle se suffise à elle-même puisqu'ils ne parlent pas comme les héros du muet, et adopter la gestuelle des premières stars du parlant. Jean Dujardin et Bérénice Bejo offrent une prestation incroyable ! Certes au début, Jean Dujardin ressemble un peu trop à Jean Dujardin : son jeu d'assurance rappelle à la fois Loulou, Brice de Nice et OSS 117. En même temps, travailler l'assurance un peu comique très jouée par le visage est sa marque de fabrique. Passé ce premier cap, il se fait oublier et devient vraiment son personnage (George Valentin). Bérénice Bejo est absolument incroyable... Elle irradie de beauté à l'écran (telle les grandes des 30's-40's) et de charme frais.
Il faut aussi citer Uggy le fantastique petit chien du film (qui a reçu le "Dog d'Or" à Cannes) qui offre lui aussi une très jolie prestation pleine de charme et de malicité !
The Artist sait rester subtilement drôle sur le monde du cinéma tout le long, et en même temps, Jean Dujardin communique parfaitement bien le mal-être de son personnage déchu. Et malgré tout cette traversée du vide que l'on accomplit avec lui, la scène finale fait sortir léger, heureux, et plein d'une bonne humeur à la Fred Aster (à qui il est fait un très gros clin d'oeil à la fin du film). Et un film qui rend heureux, ça se souligne !
Libellés :
Age d'or d'Hollywood,
Au cinéma,
Bérénice Bejo,
Cannes 2011,
Claquettes,
Film Muet,
Hazanavicius,
Jean Dujardin,
Mouvement,
Noir et Blanc,
Parlant,
The Artist,
Uggy
jeudi 6 octobre 2011
(La Délicatesse) (David Foenkinos)
J'ai lu La Délicatesse, et je l'ai lue avec mon regard à moi, celui d'une personne à qui on raconte une histoire similaire à la sienne. Alors je l'ai perçue comme je ne l'aurais sûrement pas perçue avant. J'ai tendance à croire que les endeuillés prématurés (ceux qui ont enterré ces êtres qui n'avaient pas l'âge de mourir) forment une catégorie de population à part, qui voit, vit, et comprend les choses différemment des autres.
J'ai décidé de lire certaines critiques sur ce livre, ce que j'évite de faire avant d'écrire la mienne, justement pour voir ce que les autres, les "normaux" en pensaient. J'ai lu que les procédés étaient faciles, que l'histoire était mièvre, que c'était un amalgame de pathos.
L'histoire que raconte Foenkinos est celle d'une jeune veuve qui n'a pas trente ans au décès soudain de son mari dans un accident de la circulation.
Justement, toute la réussite de La Délicatesse est d'être capable de suivre ce deuil avec simplicité (et avec délicatesse... seul point - d'ailleurs - du roman où le titre est approprié). On passe sur toute la période de choc, sur tous les moments de désespoir. On évite les interrogations sur la vie, les questionnements compliqués sur la mort, sur demain, et sur les jours d'après. En fait, Foenkinos passe court sur tout le travail de deuil. C'est sans doute ça qui a empêché les auteurs des critiques que j'ai lu d'apprécier tout cette délicatesse. Parce que cette peinture de la mort ne ressemblaient pas à celle qu'il attende, celle plus théâtrale que la vraie, mais aussi, celle plus facile.
C'est avec finesse et pudeur que Foekinos parle, à peine, de ce deuil, qu'il replace dans ce qui prend le pas sur lui : le cours de la vie. On sait de Nathalie qu'elle ne vit pas - et ne vivra plus jamais - comme les autres gens. Mais elle vit. Elle se lève, elle travaille, et elle ne pleure pas. Ce qu'on peut retenir de Foekinos, c'est qu'il a toujours le bon mot pour tout ça, le mot léger, enlevé, délicat donc, et juste.
Le livre se concentre en fait plus sur la nouvelle histoire d'amour de Nathalie. Peut-être qu'elle est caricaturale. Je ne l'ai pas vraiment lue ni comprise. C'était d'autres thèmes qui retenaient mon attention. Mais de ce que j'en ai perçu, c'était joli. Mais plutôt que délicat, fin ou léger. D'ailleurs, j'aurais plus volontiers intitulé le livre La Finesse ou La Légèreté.
La prouesse de Foenkinos, c'est aussi son art pour la digression et sa passion pour l'anodin. Tous ces petits détails inutiles et savoureux qu'il insère au milieu de son récit (souvent dans les moments plus sombres) comme pour rappeler que ce sont par les petits riens qu'on reste suspendus à la vie, et que ces petits riens sont peut-être plus efficaces partenaires de deuil que les humains.
De Nathalie, on retient beaucoup plus sa fragilité que son malheur. Certes c'est le malheur qui en est la cause, mais l'auteur nous guide vers une vision d'elle non en tant qu'endeuillée, mais en tant que femme. Et Foenkinos exprime bien cette paradoxalité de la veuve qui ne veut plus qu'on la désire en tant que femme et à qui les regards masculins indélicats apparaissent souvent peut-être plus libidineux qu'ils ne le sont, et qui en même temps souffre de cette image de veuve, de personne que l'on ne peut regarder, à qui l'on ne peut parler, comme si la malédiction de ce qu'elle vit allait rejaillir sur son interlocuteur. Il entraîne le lecteur à regarder Nathalie en tant qu'être humain (plus qu'en tant que femme d'ailleurs), en tant qu'âme à aimer, tout en soulignant l'inappropriation des regards "bout de viande", comme celui de Charles, son supérieur hiérarchique, dont, du coup, toutes les avances échouent, alors que celles de Markus, avec toute son humanité et sa tendresse finit par obtenir de Nathalie qu'elle lui laisse une chance.
La Délicatesse est donc, selon moi bien sûr, un livre très juste et qui n'a au contraire pas cédé à la facilité. Car traiter le deuil en restant léger, c'est là le douloureux exercice quotidien de tous les endeuillés, et Foekinos le traduit très joliment en mots. Un film avec Audrey Tautou réalisé par l'auteur et son frère sortira normalement à la fin 2011.
Libellés :
Audrey Tatou,
David Foenkinos,
Deuil,
Douceur,
Eric Foekinos,
Gallimard,
La Délicatesse,
Lecture,
Mes Lectures,
Roman,
Veuvage,
Veuve
jeudi 29 septembre 2011
(Habemus Papam) (Nanni Moretti)
Habemus Papam a beaucoup fait parler de lui au moment du Festival de Cannes 2011. Nanni Moretti y réussit le prodigieux exploit de réaliser un film drôle qui n'est pas une comédie. C'est un film entre mélancolie, burlesque, ironie; tout en subtilité.
Un nouveau Pape est élu. Mais cet homme est en proie aux affres de la dépression. Plombé par le manque de confiance en lui-même, il se liquéfie devant la tâche qui lui incombe, et qu'il tient pour majeure.
Tout l'intérêt du film réside dans cet oscillation perpétuelle entre les registres. Ce pourrait être grave, sérieux. Le film commence d'ailleurs ainsi, plein d'austérité. Mais le huis-clos du conclave laisse tout de suite à la dérision. Presqu'à l'auto-dérision d'ailleurs, mais une auto-dérision involontaire - du moins inconsciente - de l'Eglise.
Les cardinaux, prisonniers de la rigidité de leurs institutions, ne savent comment réagir à cette situation qui remet en cause la raison même de l'existence de l'Eglise : si le Pape n'est pas prêt à être Pape, il est tout de même réputé avoir été élu par Dieu qui a "soufflé" aux cardinaux leur vote. Il ne peut donc ne pas être intronisé. Sinon, c'est remettre en cause l'existence même de Dieu, et, en tout cas, d'une Eglise qui ne serait qu'en fait qu'une organisation oligarchique injustifiée. On sent tout le long que les cardinaux sont tentés par une solution que le huis-clos secret leur offre : celle de recommencer l'élection. Mais s'écarter - même pour le bien de l'Institution - des règles établies, c'est ouvrir eux-mêmes pour eux-mêmes une brèche dans l'inébranlabilité de leur foi.
On a d'ailleurs beaucoup lu ou entendu dans diverses critiques qu'Habemus Papam était un film sur la crise de foi d'un Pape. C'est faux. A aucun moment ce Pape ne remet en cause Dieu. Au contraire. Mais son mal remet en cause l'Eglise qui n'a pas la souplesse de l'accepter.
Le film met en exergue le piège que s'est tendue l'Eglise à elle-même : en fondant la justification de son existence sur des concepts qui refusent la psychologie, elle a créé son propre talon d'Achille. Car à la moindre apparition irréfutables des problèmes de l'inconscient (qui seraient inconciliables avec l'âme), cette justification se trouble ébranlée. En filigrane, si l'Eglise avait su être plus souple avec les concepts post-Freudiens, elle serait plus solide, et pourrait plus facilement se rapprocher du peuple, celui des gens qui sont dépressifs, qui consomment des psychotropes et vont chez des psychanalystes, sans pour autant ne pas être croyants.
Et Moretti s'amuse avec cette déconnexion naïve, avec l'isolement des pontes de l'Eglise du monde réel. Le huis-clos du conclave, où un psychiatre athée (joué par Moretti lui-même) se retrouve enfermé avec les cardinaux, lui offre la possibilité de s'amuser, comme le fait son personnage.
On découvre de vieux messieurs complètement perdus parce que la réalité s'éloigne d'un pouce des règles formelles et solennelles qu'ils connaissent. De grands enfants attendrissants qui se gavent de somnifères (comme tout le monde) tout en refusant le concept d'inconscient, de moi, de ça, et de sur-moi. Et le psychiatre joue avec eux, leur organisant des tournois de volley impromptus qui les sortent de leur austérité, alors que le directeur du Vatican peine à maintenir les apparences et s'échevine à raisonner un Michel Piccoli fugueur.
Il y a le côté sérieux, et le côté drôle du film. Et il y a aussi le côté sombre. Celui de la dépression de Piccoli. Une dépression comme l'on en croise chaque jour, à chaque coin de rue, à la machine à café, que ce soit celle d'une université ou d'une grande entreprise, à l'étage des cadres ou dans le local ménager. Ce mal du XXème siècle. Cette lassitude, cette mélancolie, cette "non-envie" (plutôt qu'une envie de rien) permanente et ce cruel manque de confiance en eux qui laissent les gens éteints. On a jamais autant parlé de la dépression, qui n'est plus vraiment un mal tabou: saisonnière, continue, légère, profonde... mais elle est bien partout (et (mal) automédiquée comme le font les cardinaux à grand renfort de somnifères).
Piccoli est troublant de vulnérabilité. Incroyablement juste. A la fois curieux de son mal, et plein d'incompréhension à son égard. On vit avec lui tout le poids de ce mal, qui n'est pas vraiment une douleur, tout juste une tristesse, et qui l'écrase.
Moretti ne manque pas, au passage, de se moquer de la psychanalyse et de ses travers. Médecins qui se battent sur l'appellation des symptômes, ou leurs causes et orientent le patient vers leur dada d'études ("carence de soin" revenant souvent), crises d'égo des psychiatres qui ne savent eux-mêmes pas gérer leur vie... C'est finalement, extérieurement à l'Eglise, tout le monde vrai qui y passe : les maladies, les remèdes, les malades et leurs traitants.
L'exploit d'Habemus Papam reste de nous faire ressortir légers, comme après une comédie, sans jamais n'avoir fait de blague. C'est la comédie de la vie qui s'est jouée, la mise en scène qui nous a fait sourire plus que le bon mot.
C'est le jeu de la subtilité qui a parlé.
Libellés :
Au cinéma,
Dépression,
Habemus Papam,
Michel Piccoli,
Moretti,
Mouvement,
Pape,
Vatican
dimanche 18 septembre 2011
(Présumé Coupable) (Vincent Garang)
Présumé Coupable est l'un de ces horribles films qui touchent au plus profond de soi, directement aux tripes. Retraçant l'histoire d'Alain Marécaux, l'un des 13 d'Outreau, l'huissier qui avait entamé une grève de la faim, il nous plonge dans l'univers carcéral et dans tous ses à côtés.
L'histoire tout le monde la connaît. Ces enfants et leurs parents qui accusent de viol treize personnes (en fait, plus d'une cinquantaine, mais seules les accusations contre ces treize là resteront tangibles) qu'on envoie en détention préventive, durant trois longues années, dont on place les enfants dans des familles d'accueil (leurs véritables familles pouvant les influencer en faveur de leurs parents), et que les médias surexposent.
Le film est humainement parfaitement juste. Philippe Torreton offre une interprétation absolument extraordinaire. Il est Alain Marécaux, tâche d'autant moins aisée que ce petit huissier au crâne rasé est presque quelqu'un qu'on connaît, tant il a été l'un des emblèmes des prévenus d'Outreau. Sa transformation physique, effrayante, digne de celle de Tom Hanks pour Philadelphia (une perte de plus de 20 kilos), entraîne d'autant plus le spectateur dans la spirale infernale de la dépression, de l'incompréhension, du suicide.
Qu'il est gênant de voir cet homme enfermé entre quatre murs, et enfermé en lui-même, presque comme une personne psychiatriquement malade, parce qu'on refuse de l'écouter, comme si sa réalité à lui n'était pas la réalité des autres. Ses quatre tentatives de suicide, qui semblent (selon l'orientation du film, elle-même fondée sur le récit d'Alain Marécaux) plus révéler une vraie volonté de mourir qu'un appel au secours, n'alertent pas les autorités carcérales ou judiciaires. L'homme n'est pas encore jugé coupable. Il est en détention préventive, une mesure censée être exceptionnelle et justifiée par la nécessité d'isoler le prévenu pour le bienfait de l'enquête. Quand la prison et l'opprobre publique deviennent un tel supplice pour une personne qui est toujours réputée innocente, ne devrait-on pas lui laisser une chance au dehors, quitte à "délocaliser" la personne des lieux de l'enquête ? Ou à la placer, comme il fût fait quelques semaines avant que le juge ne redemande le placement en prison, dans une institution médicalisée ?
On devient Alain Marécaux. On prend sa douleur, son enfermement, l'incompréhension qu'on lui oppose, et cet énorme sentiment d'injustice (renforcé par le vrai éclatement du fond de l'affaire que nous connaissons tous). Les personnages secondaires eux aussi offrent un moment de vérité. Sa soeur et son père apparaissent très peu, mais leurs 10 minutes de jeu mises bout à bout sont autant de moments de vérité. Le décès de la mère offre au film une nouvelle occasion de montrer ses traits de justesse... Mon expérience personnelle du deuil m'offre un nouvel oeil sur les scènes de film qui l'abordent: les justes, et les moins justes (qu'elles ressemblent ou non à mon propre vécu... c'est juste qu'elles offrent ce petit quelque chose qui dit "je te comprends, je vis ce que tu vis"). Et définitivement, celle-ci fait partie des plus justes que j'aie vues.
Il est bien agréable de voir un film qui ne dépeigne pas l'univers carcéral selon le nouveau stéréotype façon Animal Factory. Alain Marécaux y est entré huissier (et les professions juridiques, notamment celles malaimées comme la sienne, y sont mal vues) et "violeur d'enfant", ce que son avocat lui a bien rappelé de cacher. Le film montre la saleté de la prison, l'inconvénient de vivre à 6 dans une cellule miteuse et minuscule, sans intimité, sans possibilité de se reposer. Mais pas de scène façon Un Prophète, juste l'horreur de la prison dans "sa normalité".
En filigrane (mais un filigrane intense), le problème typiquement bureaucrate du placement des enfants, qui sont des humains. D'ailleurs, une petite envolée lyrique (la seule) de Torreton, lors d'un jugement sur la garde des enfants, aborde ce problème de l'humain oublié par le bureau. Les enfants Marécaux, que l'on place dans des familles d'accueil, alors qu'ils ont besoin d'amour et de compréhension, qui plongent: drogue, fugues, TS, déscolarisation... illustrent ce problème bien connu, mais duquel on parle peu : le sort des enfants de ceux qu'on envoie en prison.
Petit bémol: le juge Burgaud. L'acteur lui ressemble trait pour trait. Il est presque relégué au second rôle. Il ressort arrogant et inhumain. Complètement. Cela parait presque manichéen. Pas de tentative de justifier ses non-excuses par son propre déni (coupable) ou la peur d'être radié de la magistrature. Juste la description d'un homme qui a condamné à l'avance (ce qui est manifestement vrai) et ne s'en mord absolument pas les doigts. C'était peut-être le cas, je n'ai aucun moyen de le déterminer. Mais cela donne aux esprits critiques l'occasion de penser que le film manque un tout petit peu d'objectivité, ce qui est dommage au milieu de toute cette justesse.
Libellés :
Au cinéma,
Cinéma,
Mouvement,
Outreau,
Philippe Torreton,
Présumé Coupable
mardi 13 septembre 2011
L'Ombre du Vent, José Luis Zafon
L'Ombre du Vent est l'un des meilleurs livres que j'ai lus ces derniers mois. Et un livre qui gardera chez moi une dimension peu objective, celle d'avoir été un soutien personnel. Sa qualité première: être l'un de ces livres qui captivent et entrainent complètement dans leur univers. On fait abstraction de sa propre vie, alors même que des passages pourraient nous y renvoyer.
On est Daniel, le héros, qui narre à la première personne. On s'enfonce avec lui dans la Barcelone des années 50, on apprend à aimer les livres et les femmes qu'il aime. Fantômes et vivants se mêlent, imperceptiblement. Toute cette ambiance inquiétante, surannée, presque glauque à certains moments, absorbe le lecteur.
Chaque personnage, même extrêmement secondaire, dégage tellement vite sa propre existence, son propre caractère que l'on apprivoise, qu'on le découvre, et qu'on apprend de lui. Tout, dans ce livre quasi fantastique, parait tellement réaliste...
La plume est incroyable de qualité, comme l'on en croise rarement... Il dégage son univers, ses odeurs, son essence avec autant d'intensité que le Parfum de Suskind...
Plutôt que d'en parler, il faut le lire.
Libellés :
Barcelone,
Lecture,
Mes Lectures,
Ombre du Vent,
Zafon
vendredi 2 septembre 2011
Nanards de la semaine: Captain America et Les Cowboys Envahisseurs
La semaine dernière, j'ai joué les cinéphiles... (ou pas), et suis allée voir deux grosses superproductions Hollywoodiennes.
Commençons par le pire, de façon à ce que le meilleur en tire du rab de gloire. Cowboys et Envahisseurs est clairement ma "bouse cinématographique" de l'année 2011, de celles qui font vraiment regretter d'avoir dépensé de l'argent.
Mais qu'est-il passé par la tête de Daniel Craig et Harrisson Ford ? Ils sont tous les deux excessivement connus, n'ont pas joué les rôles les plus prenants de l'histoire du 7ème art, mais toujours des choses correctes. Ils n'ont pas besoin d'argent, peuvent se négocier et même refuser un film nul. Là, ils sont deux à s'y être embarqués.
Pour faire simple, les aliens débarquent chez les cowboys, raptent leurs familles pour en tirer de l'or parce qu'ils sont très méchants, et ceux qui restent au village (deux mâles dominants, les deux lascars sus-cités, et des anti-héros basiques) partent en guerre contre eux pour sauver les leurs.
Effets spéciaux à gogo, mais pas de la meilleure qualité. Les aliens sont calqués sur le modèle gluant de la saga Alien justement. C'est d'ailleurs excessivement lassant que les formes de vie extra-terrestres soient toujours dépeintes soit en choses immondes gluantes façon insecte larvé, soit en petits bonhommes verts sympathiques. Finalement, Spielberg et E.T étaient peut-être les plus originaux. Les aliens ne parlent pas, vivent dans le noir...
Une magnifique et farouche jeune femme (il faut bien le petit ingrédient romantique) est alors parmi les humains à se battre. C'est en fait elle aussi une extra-terrestre, mais d'une autre planète que celle des envahisseurs qui ont exterminé son peuple. Elle a donc pris apparence humaine pour sauver la terre, et se sacrifier afin de détruire les méchants (roulements de tambour dramatiques et tonitruants pour accompagner). Evidemment, elle fait les yeux doux - et réciproquement - à Daniel Craig (un veuf toujours amoureux de sa femme), ça, c'est le quota sexuel platonique essentiel dans tout film à gros budget. Il faut quand même souligner qu'Olivia Wilde est vraiment belle. Il y a quelque chose d'intriguant dans son visage, et c'est elle qui colle le plus subtilement à son rôle (même si ce n'est quand même pas subtil).
Ce film est une caricature du début à la fin, et rien n'est bon à y prendre... Aucun effort d'imagination de la part du metteur en scène Jon Favreau, simplement une addition d'ingrédients vus et revus, et sans harmonie, avec excès. Pas même la sensation d'être diverti.
Captain America était bien meilleur. Ce n'est pas le film de l'année, mais il est rondement mené. Il faut saluer la qualité graphique... une partie vraiment large du film était en 3D... Beaucoup plus que le dernier film en 3D que j'ai vu (Pirates des Caraïbes).
L'ambiance Marvel était assez bien posée, même s'il y a des longueurs dans le film. Pas d'audace, pas d'originalité, mais un film honnête, qui occupe avec succès un soir. Un bon film à gros budget comme on s'y attend, sans grande surprise, mais qui remplit très convenablement son rôle.
Un peu dommage qu'il manque de finesse psychologique dans les caractères. Ce sera peut-être exploité dans une suite, puisque de toutes façons, elle est quasiment annoncée à la fin. Une suite totalement émancipée de Marvel car elle se situerait, d'après le dernier plan, en 2011.
Commençons par le pire, de façon à ce que le meilleur en tire du rab de gloire. Cowboys et Envahisseurs est clairement ma "bouse cinématographique" de l'année 2011, de celles qui font vraiment regretter d'avoir dépensé de l'argent.
Mais qu'est-il passé par la tête de Daniel Craig et Harrisson Ford ? Ils sont tous les deux excessivement connus, n'ont pas joué les rôles les plus prenants de l'histoire du 7ème art, mais toujours des choses correctes. Ils n'ont pas besoin d'argent, peuvent se négocier et même refuser un film nul. Là, ils sont deux à s'y être embarqués.
Pour faire simple, les aliens débarquent chez les cowboys, raptent leurs familles pour en tirer de l'or parce qu'ils sont très méchants, et ceux qui restent au village (deux mâles dominants, les deux lascars sus-cités, et des anti-héros basiques) partent en guerre contre eux pour sauver les leurs.
Effets spéciaux à gogo, mais pas de la meilleure qualité. Les aliens sont calqués sur le modèle gluant de la saga Alien justement. C'est d'ailleurs excessivement lassant que les formes de vie extra-terrestres soient toujours dépeintes soit en choses immondes gluantes façon insecte larvé, soit en petits bonhommes verts sympathiques. Finalement, Spielberg et E.T étaient peut-être les plus originaux. Les aliens ne parlent pas, vivent dans le noir...
Une magnifique et farouche jeune femme (il faut bien le petit ingrédient romantique) est alors parmi les humains à se battre. C'est en fait elle aussi une extra-terrestre, mais d'une autre planète que celle des envahisseurs qui ont exterminé son peuple. Elle a donc pris apparence humaine pour sauver la terre, et se sacrifier afin de détruire les méchants (roulements de tambour dramatiques et tonitruants pour accompagner). Evidemment, elle fait les yeux doux - et réciproquement - à Daniel Craig (un veuf toujours amoureux de sa femme), ça, c'est le quota sexuel platonique essentiel dans tout film à gros budget. Il faut quand même souligner qu'Olivia Wilde est vraiment belle. Il y a quelque chose d'intriguant dans son visage, et c'est elle qui colle le plus subtilement à son rôle (même si ce n'est quand même pas subtil).
Ce film est une caricature du début à la fin, et rien n'est bon à y prendre... Aucun effort d'imagination de la part du metteur en scène Jon Favreau, simplement une addition d'ingrédients vus et revus, et sans harmonie, avec excès. Pas même la sensation d'être diverti.
Captain America était bien meilleur. Ce n'est pas le film de l'année, mais il est rondement mené. Il faut saluer la qualité graphique... une partie vraiment large du film était en 3D... Beaucoup plus que le dernier film en 3D que j'ai vu (Pirates des Caraïbes).
L'ambiance Marvel était assez bien posée, même s'il y a des longueurs dans le film. Pas d'audace, pas d'originalité, mais un film honnête, qui occupe avec succès un soir. Un bon film à gros budget comme on s'y attend, sans grande surprise, mais qui remplit très convenablement son rôle.
Un peu dommage qu'il manque de finesse psychologique dans les caractères. Ce sera peut-être exploité dans une suite, puisque de toutes façons, elle est quasiment annoncée à la fin. Une suite totalement émancipée de Marvel car elle se situerait, d'après le dernier plan, en 2011.
Libellés :
Blockbusters,
Captain America,
Cowboys,
Envahisseurs,
Mouvement,
Nanard
dimanche 7 août 2011
American Tabloid (James Ellroy)
Pavé d'été (ou pavé d'hiver), bonjour !
Ce livre de James Ellroy, s'inscrivant dans une trilogie "Underworld USA", couvre de 1958, où JFK est sénateur, au décès de ce dernier...
Hybride entre polar et livre-historique-révélation, American Tabloid est sans conteste signé Ellroy. Dans tous ses bons et ses mauvais côtés.
Les cinquante premières pages sont absolument affreuses. Elles donnent envie de s'arrêter là. Excessivement dense et promettant une lecture laborieuse, l'introduction essaie de planter le décor dans la mafia des années 50 à travers un horrible argot, l'omniprésence du sexe dépeint salement et vulgairement par des personnages qui le résument à ça, et toutes les caricatures des polars noirs comme dans le Dahlia Noir.
Malgré tout, quinze ans de bonnes critiques m'ont donné envie de continuer. A raison.
American Tabloid est avant toute chose un roman qui s'apprivoise et qui ne supporte pas d'être délaissé. Un peu d'inattention, et c'est un détail crucial, une alliance essentielle, un revirement de situation ou un plan politique machiavélique que l'on rate. Il y a une quantité absolument insupportable de personnages, qu'ils soient réels ou fictionnels... mais chacun d'eux joue un rôle crucial, nécessairement, même si parfois éclair.
C'est un projet ambitieux: écrire l'administration Kennedy et l'enchevêtrement de conflits (ou convergence) d'intérêts qui gravitent autour. Mafia, CIA, communisme, anti-communisme, monde des affaires. Tout se mêle. Toutes ces organisations dont on sait qu'elles sont de près, de loin, et indirectement mais sûrement liée à la politique jouent moult doubles-jeux, à travers tout autant d'agents doubles. Mais Ellroy écrit cette administration en restant avant tout ce qu'il est: un auteur de polar.
Se mêlent alors la vérité et la fiction. La complexité de personnages tels que Kemper Boyd, qui travaille pour Hoover en espionnant les Kennedy, travaille pour les Kennedy en espionnant Hoover, et travaille pour lui à l'aide de la mafia et de la CIA pour éliminer les frères Castro, ou de Pete Bondurant, un Français dont on ne comprend pas finalement bien ce qu'il fait là, et enfin Ward Littell, le plus emblématique du désordre idéologique qu'incarnent tous ces milieux.
La partie "histoire" est grandement menée. Détaillée. Précise. Et la partie polar tout autant. On s'y prend. On halète. La fin de l'Histoire, on la connait. Kennedy meurt, le coup d'Etat de la Baie des Cochons échoue. Pour autant, on se demande, on y croit, on tremble avec tous ces hommes. Et surtout on plonge toujours plus profondément avec eux dans ce "merdier" inextricable, cette chienlit politico-mafieuse dont on ne revient pas, et que finalement, on ne peut combattre.
Il faut lire American Tabloid. Pour voyager quelques 800 pages dans un monde dont on ne regrette plus de ne pas le connaître.
Libellés :
Ellroy,
Espionnage,
Kennedy,
Lecture,
Mes Lectures,
Roman Noir,
Thriller
jeudi 4 août 2011
Fastes et Grandeur des Cours d'Europe (Grimaldi Forum, Monaco)
D'ordinaire plutôt satisfaite des expositions d'été du Grimaldi Forum, je clame pour 2011 la déception.
Fastes et Grandeur des Cours d'Europe me donnait l'idée d'une exposition temporellement riche qui retracerait des époques diverses et justement la construction d'une cour.
L'ambiance de l'exposition était parfaite. Petite musique de chambre, accueil par des rangs de tenue de laquais comme pour une haie d'honneur jusqu'au patio central avec des carrosses...
Ce patio plein de dorures (mais avec un sol en lino qui colle) plonge directement dans le décor. Rond, toute une série de petites salles donnent sur lui.
Chaque salle est découpée en un pays. Premier souci: il faut aller au fond des salles étroites, et faire demi-tour ensuite pour rejoindre le patio afin de savoir dans la salle de quel pays l'on entre ensuite.
Ensuite, ce choix de découpage par pays restreint l'exposition. Le commissaire a du choisir un monarque emblématique par cour. Pour la France, c'est Napoléon, pour l'Autriche Louis II de Bavière... Du coup, l'aspect "grandeur" des Cours est vraiment partiel. Elle manque également de cohérence. On a l'impression que ce découpage par pays a permis de coller des vestiges du règne comme témoins. En effet, hormis une brève présentation de la vie du monarque (ascendance, mariage, adultère et enfants uniquement... aucune inscription réellement historique), et une toile le représentant lui et son/sa consort, c'était principalement de la vaisselle, des vêtements et du petit mobilier qui étaient exposés. Une façon de percevoir l'esthétique de la période, mais en aucun cas d'en comprendre la Cour qui finalement était la grande absente de l'exposition. En effet, jamais on n'y parle de ses codes, de ses membres ou de sa place sociétale.
C'est une exposition qui aurait été plus agréable si elle avait été intitulée "Styles de Vie sous les Royautés Européennes" ou quelque chose de mieux. Là, l'intitulé et les attentes historiques qu'il suscite ne collent pas avec ce qui est exposé. Au final, ça m'a paru être un grand bazar incohérent.
Enfin, il faut souligner l'énorme problème du Grimaldi Forum dont les salles climatisées ne dépassent pas les 19 degrés, ce qui rend la visite insupportable... Et enfin, cette affreuse manie d'interdire les photos m'exaspère au possible !
jeudi 21 juillet 2011
Ombre à Paupière Bourjois ("boîte ronde")
 |
| Boites Rondes, Bourjois, environ 11E |
J'ai testé la version 2.0 des ombres à paupières Bourjois, si bien mise en avant dans tous les rayons maquillage des supermarchés. Ayant une bonne image de Bourjois, attirée par ces mignonnes petites boîtes rondes, j'ai sauté le pas et eu envie d'un peu d'excentricité en investissant dans le vert anis pétant (la deuxième en haut en partant de droite).
<--La publicité me promettait ceci (suivre ma jolie flèche à gauche). Le fard n'avait pas de nom, simplement "n°1" de la gamme "saturée". Il existait un vert un peu plus pâle avec lequel j'ai hésité, de peur que celui-ci ne soit trop intense...
Et bien, c'est une belle arnaque. Déjà, le fard est super poudré, et s'effrite au passage du petit pinceau mousse fourni. La couleur est fade, et l'ombre a énormément de mal à accrocher la paupière. Il faut passer et repasser, et ne pas espérer le résultat de la photo à moins de se frotter directement la paupière sur la boite. Quant à la tenue, elle est très médiocre.
Il n'y a finalement que la boite de jolie, et de bien conçue du reste...
Libellés :
Boîtes Rondes,
Bourgeois,
Futilités Dermatologiques,
Maquillage,
Ombre à Paupières
Body Shop Review
 |
| Cubes Lumière 06 |
Les soldes aidant, j'ai pu enrichir ma gamme de maquillage Body Shop, qui pour le moment se limitait aux cubes lumières 06 (dans les teintes marrons) et à un fond de teint compact acheté en 2007. Si ce dernier ne me satisfaisait pas (teinte trop jaune, texture trop grasse et boîtier trop "plastique"), les cubes lumières eux sont pour moi un réel bonheur. Quantité ultra généreuse pour une prix très raisonnable (22e le damier) qui fait que 5 ans après la palette n'est toujours pas épuisée, texture irisée, couleur bien pigmentée et excellente tenue ont contribué à propulser pour moi Body Shop au grade de maquilleur et pas seulement de "crémeur", alors que finalement, je ne connaissais rien de leur gamme maquillage. Depuis trois mois, j'ai donc tenté moult produits.
Pour continuer dans les ombres à paupières, j'ai tenté la gamme "Fusion". Un boitier bombé en deux nuances: une première, et une plus petite deuxième plus foncée. Les deux couleurs sont "irrégulières" et parsemées de filets de couleurs différentes. J'ai acheté l'améthyste. La couleur est riche, bien proche de celle de la pierre précieuse, et sur la tenue, il n'y a rien à redire. La forme bombée de la palette la rend en revanche difficile à saisir au pinceau, et donc difficile à bien appliquer en nuances.
 |
| Fusion Amethyst |
Deux découvertes: les palettes éphémères de la gamme "Brush with Passion". Designées par le London College of Fashion, en plus d'être jolies et originales, Body Shop s'est dépassé sur la couleur et est sorti de son maquillage traditionnel qui manque parfois de diversité. Vendues 22E en avril, elles ont été soldées à 11e en juillet.
J'avais initialement acheté celle dans les tons roses. Les couleurs ont l'air un peu agressives dans la palette, alors qu'elles sont plus subtiles sur la paupière. Du moins, on peut très aisément en travailler l'intensité. Le gris métallisé est très doux, le noir est facile à tamiser, et le rose est beaucoup "Barbie" qu'il ne le semble, bien qu'un peu pailleté. le blanc est très léger: pratique pour éclaircir le coin de l'oeil, décevant pour celles qui voudraient taper du blanc-blanc. A souligner un grand miroir qui rend la palette très pratique dans un sac, son pinceau personnel, et un mini-crayon khôl noir assez pratique (et doux à appliquer).

Assez satisfaite, je me suis donc laissée séduire pendant les soldes par la palette marron. Qui en fait, m'a beaucoup plus emballée que la rose. Les couleurs chaudes sont vraiment très profondes, très faciles à appliquer, et parfaitement mat et bien intense. Là encore, pinceau "personnel"et cette fois petit khôl marron.
Et enfin, la révélation qui ne m'a coûté que 6 euros (merci les soldes): la base de teint illuminatrice, toujours de la gamme Brush with Passion. Disponible en deux nuances (une plus claire et une plus foncée), c'est avec elle que je me suis initiée à cette chose dont je n'avais pas encore découvert l'utilité: la base de teint.
 Déjà: j'adore le principe du pinceau intégré. Propre, hygiénique, et qui évite de mélanger les différents pinceaux. La base de teint est à appliquer sous le fond de teint. J'ai donc pris sur moi de me pinturlurer le visage. Et effectivement, effet bonne mine assuré. On voyait beaucoup moins que j'avais du fond de teint, ma peau ressemblait à celle d'un bébé, parfaitement douce au toucher. On ne voyait absolument plus mes pores (que je n'ai vraiment pas très gros, mais assez profonds), et mon teint est resté aussi bien toute la journée malgré la clim du travail.
Déjà: j'adore le principe du pinceau intégré. Propre, hygiénique, et qui évite de mélanger les différents pinceaux. La base de teint est à appliquer sous le fond de teint. J'ai donc pris sur moi de me pinturlurer le visage. Et effectivement, effet bonne mine assuré. On voyait beaucoup moins que j'avais du fond de teint, ma peau ressemblait à celle d'un bébé, parfaitement douce au toucher. On ne voyait absolument plus mes pores (que je n'ai vraiment pas très gros, mais assez profonds), et mon teint est resté aussi bien toute la journée malgré la clim du travail.
Seul bémol de mon panier Body Shop: le rouge à lèvres "glisse color intense" (gamme qui va être arrêtée visiblement) dans la couleur 66, un corail. La couvrance est moyenne, la couleur, jolie dans la tube, est fade sur les lèvres...
Je retiens donc de tous ces achats que Body Shop est en plein dépoussiérage de sa gamme maquillage, qui, bien que de qualité, manquait d'originalité... et vu les prix avantageux, ça donne envie d'acheter!
dimanche 26 juin 2011
Le Chat du Rabbin
Le chat du Rabbin - le film - est une bien jolie surprise. Avant toute chose, j'ai compris d'où le réalisateur de "Gainsbourg, vie héroïque" a sorti la tête de son Gainsbarre. En effet, Johann Sfar, le réalisateur du film sur Gainsbourg est également le dessinateur de la BD (en cinq tomes) Le Chat du Rabbin. Le Gainsbarre qui hante Gainsbourg dans le film ressemble étrangement au chat.
Le synopsis est simple: le chat d'un rabbin, dans l'Alger du XXème siècle, narrateur de l'histoire, est doté de la parole, et entreprend avec son maître, et d'autres personnages colorés, un périple vers Jérusalem.
Le dessin est très original. La courbe ronde, la douceur de la couleur, ouvrent un monde de délices, gourmand, et généreux: une sorte de temple du "bien-vivre".
Il faut souligner l'excellente bande-originale (hormis la chanson de clôture d'Enrico Macias, qui, à mon sens, vient la gâcher, par toute sa caricaturalité), toute en musiques orientales, qui invite au voyage, et fait pénétrer au coeur d'un monde entièrement construit par Sfar auquel on veut croire.
Ce monde "donne envie", malgré toutes les "mochetés de la vie" que Sfar ne cache pas. En effet, dans cette Alger coloniale où les cafés ne servent "ni les Juifs, ni les Arabes" mais où ces derniers, également rejetés, se rejettent mutuellement, tout n'est pas rose. La bureaucratie française en prend pour son grade, tout comme le fanatisme religieux. Et pourtant, le monde du chat et du rabbin n'inspire que du bonheur et de la joie. L'espoir flotte partout. On ressort du cinéma heureux.
Il convient de noter l'excellence des personnages, et de leurs dialogues. Le chat, au centre, est incroyable, tant il se partage entre un cynisme malin, et une innocence délicieuse. Le rabbin et son cousin l'imam (rien que cette parenté est belle), en vieux monsieurs pleins d'amour sont attachants... et autour d'eux, tous apportent un petit quelque chose de plus, qui rend le film gai et haut en couleurs.
Mais surtout, derrière le dessin animé, derrière l'histoire "mignonnette" et les personnages attachants, se cachent (à peine) toute une série de réflexions profondes.
Sur la religion d'abord. Le chat, lui, est athée. Le rabbin, évidemment, non. Son cousin, musulman, ne croit pas aux mêmes choses que lui, mais se sent lié à lui parce qu'eux croient en quelque chose de commun: Dieu. S'en suivent différentes questions, sur la relation entre les religions, sur la façon de les prendre, sur la nécessité de les croire à la lettre ou de croire en leur fonction étiologique. Aucune réponse n'est réellement apportée. Mais un compromis de toutes ces opinions se forme et mène à un seul résultat: celui de la solidarité entre les hommes.
L'autre réflexion importante porte sur le langage. En effet, le film débute avec la prise du langage par le chat. Puis, ce dernier ne peut plus parler, jusqu'à ce qu'il rencontre le peintre russe, qui sera alors le seul à l'entendre. Enfin, lorsqu'il manque de mourir, il retrouve à nouveau la parole. Il expliquera son soudain silence par la non-écoute de ses maîtres. On ne sait donc pas s'il a réellement parlé, ou si seulement, la communication pour Sfar outrepasse le langage et relève plutôt de l'observation (et d'un échange qui lui est consécutif). Il y a d'ailleurs un passage très intéressant. Le chat raconte qu'avant de parler, il rêvait qu'il courait derrière des papillons, ou qu'il était pourchassé par des animaux plus gros que lui. Or, depuis qu'il parle, il rêve que sa maîtresse meurt, et que son père, le rabbin, sombre dans la dépression. De la part d'un auteur professeur de philosophie, cette anecdote n'est pas anodine, et ouvre à la réflexion sur notre relation avec la mort. Outre qu'elle est culturelle, elle serait donc inhérente à nos sociétés de communication orale. Il est impossible de déterminer ce que Sfar en pense réellement, mais cela invite à réfléchir à ce sujet.
Le Chat du Rabbin est un film plein de sens, qu'il faut sans doute visionner à plusieurs reprises pour en saisir l'étendue de la réflexion. Il sera également bienvenu de lire les 5 tomes de la BD.
Le synopsis est simple: le chat d'un rabbin, dans l'Alger du XXème siècle, narrateur de l'histoire, est doté de la parole, et entreprend avec son maître, et d'autres personnages colorés, un périple vers Jérusalem.
Le dessin est très original. La courbe ronde, la douceur de la couleur, ouvrent un monde de délices, gourmand, et généreux: une sorte de temple du "bien-vivre".
Il faut souligner l'excellente bande-originale (hormis la chanson de clôture d'Enrico Macias, qui, à mon sens, vient la gâcher, par toute sa caricaturalité), toute en musiques orientales, qui invite au voyage, et fait pénétrer au coeur d'un monde entièrement construit par Sfar auquel on veut croire.
Ce monde "donne envie", malgré toutes les "mochetés de la vie" que Sfar ne cache pas. En effet, dans cette Alger coloniale où les cafés ne servent "ni les Juifs, ni les Arabes" mais où ces derniers, également rejetés, se rejettent mutuellement, tout n'est pas rose. La bureaucratie française en prend pour son grade, tout comme le fanatisme religieux. Et pourtant, le monde du chat et du rabbin n'inspire que du bonheur et de la joie. L'espoir flotte partout. On ressort du cinéma heureux.
Il convient de noter l'excellence des personnages, et de leurs dialogues. Le chat, au centre, est incroyable, tant il se partage entre un cynisme malin, et une innocence délicieuse. Le rabbin et son cousin l'imam (rien que cette parenté est belle), en vieux monsieurs pleins d'amour sont attachants... et autour d'eux, tous apportent un petit quelque chose de plus, qui rend le film gai et haut en couleurs.
Mais surtout, derrière le dessin animé, derrière l'histoire "mignonnette" et les personnages attachants, se cachent (à peine) toute une série de réflexions profondes.
L'autre réflexion importante porte sur le langage. En effet, le film débute avec la prise du langage par le chat. Puis, ce dernier ne peut plus parler, jusqu'à ce qu'il rencontre le peintre russe, qui sera alors le seul à l'entendre. Enfin, lorsqu'il manque de mourir, il retrouve à nouveau la parole. Il expliquera son soudain silence par la non-écoute de ses maîtres. On ne sait donc pas s'il a réellement parlé, ou si seulement, la communication pour Sfar outrepasse le langage et relève plutôt de l'observation (et d'un échange qui lui est consécutif). Il y a d'ailleurs un passage très intéressant. Le chat raconte qu'avant de parler, il rêvait qu'il courait derrière des papillons, ou qu'il était pourchassé par des animaux plus gros que lui. Or, depuis qu'il parle, il rêve que sa maîtresse meurt, et que son père, le rabbin, sombre dans la dépression. De la part d'un auteur professeur de philosophie, cette anecdote n'est pas anodine, et ouvre à la réflexion sur notre relation avec la mort. Outre qu'elle est culturelle, elle serait donc inhérente à nos sociétés de communication orale. Il est impossible de déterminer ce que Sfar en pense réellement, mais cela invite à réfléchir à ce sujet.
Le Chat du Rabbin est un film plein de sens, qu'il faut sans doute visionner à plusieurs reprises pour en saisir l'étendue de la réflexion. Il sera également bienvenu de lire les 5 tomes de la BD.
lundi 20 juin 2011
Beginners (de Mike Mills)
Beginners est un joli film. Avec une certaine indolence, et une image résolument rétro. Dès le début, le film est situé en 2003. Pour autant, tant les décors, que le grain de l'image, ou la voiture du héros, Ewan McGregor, une vieille Mercedes des années 80 (alors que son personnage ne manque vraisemblablement pas d'argent) participent de cette ambiance surannée, et mélancolique.
C'est un film qui joue avec l'image. Un jeu un peu simple, un peu attendu. Des successions d'images présentes "par association d'idées" à la façon d'Amélie Poulain. Pour autant, malgré la facilité de l'idée, on se laisse prendre, et cela contribue à une atmosphère générale au charme désuet.
Beginners aborde plusieurs thèmes, filés. Le deuil, la maladie, l'arrivée d'une tierce personne dans le processus de deuil, et l'homosexualité. Le synopsis est plutôt simple: Oliver (Ewan McGregor) voit son père de 75 ans lui avouer son homosexualité au décès de sa mère. Le vieil homme lui confie se savoir gay depuis toujours, et avoir "essayé de se guérir" au début. Il décide donc d'assumer sa sexualité, malgré son âge avancé, et rencontre Andy (Goran Visjnic, ancien acteur d'Urgences), plus jeune que lui, et très différent du milieu intellectuel qu'a toujours fréquenté cet ancien directeur de musée. Au décès de son père, Olivier se retranche sur lui-même. Il rencontre alors Anna (Mélanie Laurent), une actrice française. Cette dernière ne sait pas comment se placer par rapport à lui. Elle dira d'ailleurs qu'elle ne sait pas si elle peut combler le vide laissé par le père d'Olivier.
Le film s'ouvre sur Oliver rangeant les affaires de son père que l'on sait décédé. Il repart cinq ans auparavant, par flashback, lorsque ce dernier lui annonce son homosexualité. Dès lors, le film ne fait qu'aller entre trois époques: 2003, où Oliver rencontre Anna, la période 1998-2003 où son père est malade, et l'enfance d'Oliver.
Le film aborde pudiquement l'homophobie du XXème siècle, et la peur de ces nombreux hommes de s'y confronter, et donc de s'assumer. Il n'y a aucune dénonciation violente, aucune critique. Juste cette pointe d'amertume, vécue à travers le père d'Oliver qui se reproche sa lâcheté. C'est une façon très douce d'aborder un sujet d'ordinaire traité avec le feu de la dénonciation. Pour autant, ça ne lui en fait pas perdre de son efficacité.
On vit avec le père d'Oliver le combat contre la mort, la volonté effrénée de la nier, et de la repousser. S'il vit de façon plus intense parce qu'il sait que les jours lui sont comptés, il refuse de voir la mort à terme. Cela semble dire (mais chacun projette son vécu) que la mort annoncée n'y prépare pas plus que la mort brutale. Elle laisse tout au plus le temps d'ajuster son comportement. Mais cela soulève quelques questions: est-ce une bonne chose? Cela permet-il de rester soi, vrai, et de partir comme on était plutôt que comme l'on voudrait être?
Mais le thème principal du film reste le deuil, en l'occurrence, celui d'Oliver. C'est lui qui ouvre le film, et qui le clôt. Là aussi, il est filmé avec beaucoup de pudeur. Il laisse en bouche l'amertume de la solitude, ce sentiment presqu'évanescent, léger, subtil, et surtout, permanent. Il illustre le désoeuvrement dans lequel plonge le deuil.
Or, l'arrivée d'Anna (Mélanie Laurent) dans le film, et dans le deuil d'Oliver est un tournant. Au début, c'est une bouffée d'air. Un élément nouveau. Très vite, les deux personnages s'attachent l'un à l'autre. Leur relation, faite de pitreries, est d'ailleurs très touchante, et lumineuse. Mais c'est là que vient la question d'Anna: puis-je compenser le vide laissé par ce deuil?
La situation est compliquée pour les deux. Pour l'endeuillé qui ne parvient à s'extirper de son deuil, et n'ose pas d'ailleurs le faire. Mais aussi pour "le tiers", impuissant, qui peine à trouver sa place.
Ce sera d'ailleurs la cause de la rupture des deux héros.
Jusqu'à ce qu'Oliver fasse enfin son deuil. C'est symbolisé par l'arrivée du flash-back au décès de son père. En effet, le retracement de l'acceptation de sa maladie par le père est parallèle au propre processus de deuil du fils. C'est alors que la place pour Anna se libère vraiment.
Beginners est réellement un joli film. Tout en charme et en pudeur, avec une délicatesse de l'image, des voix, de la musique, qui se perd dans le cinéma et dans la vie.
C'est un film qui joue avec l'image. Un jeu un peu simple, un peu attendu. Des successions d'images présentes "par association d'idées" à la façon d'Amélie Poulain. Pour autant, malgré la facilité de l'idée, on se laisse prendre, et cela contribue à une atmosphère générale au charme désuet.
Beginners aborde plusieurs thèmes, filés. Le deuil, la maladie, l'arrivée d'une tierce personne dans le processus de deuil, et l'homosexualité. Le synopsis est plutôt simple: Oliver (Ewan McGregor) voit son père de 75 ans lui avouer son homosexualité au décès de sa mère. Le vieil homme lui confie se savoir gay depuis toujours, et avoir "essayé de se guérir" au début. Il décide donc d'assumer sa sexualité, malgré son âge avancé, et rencontre Andy (Goran Visjnic, ancien acteur d'Urgences), plus jeune que lui, et très différent du milieu intellectuel qu'a toujours fréquenté cet ancien directeur de musée. Au décès de son père, Olivier se retranche sur lui-même. Il rencontre alors Anna (Mélanie Laurent), une actrice française. Cette dernière ne sait pas comment se placer par rapport à lui. Elle dira d'ailleurs qu'elle ne sait pas si elle peut combler le vide laissé par le père d'Olivier.
Le film s'ouvre sur Oliver rangeant les affaires de son père que l'on sait décédé. Il repart cinq ans auparavant, par flashback, lorsque ce dernier lui annonce son homosexualité. Dès lors, le film ne fait qu'aller entre trois époques: 2003, où Oliver rencontre Anna, la période 1998-2003 où son père est malade, et l'enfance d'Oliver.
Le film aborde pudiquement l'homophobie du XXème siècle, et la peur de ces nombreux hommes de s'y confronter, et donc de s'assumer. Il n'y a aucune dénonciation violente, aucune critique. Juste cette pointe d'amertume, vécue à travers le père d'Oliver qui se reproche sa lâcheté. C'est une façon très douce d'aborder un sujet d'ordinaire traité avec le feu de la dénonciation. Pour autant, ça ne lui en fait pas perdre de son efficacité.
On vit avec le père d'Oliver le combat contre la mort, la volonté effrénée de la nier, et de la repousser. S'il vit de façon plus intense parce qu'il sait que les jours lui sont comptés, il refuse de voir la mort à terme. Cela semble dire (mais chacun projette son vécu) que la mort annoncée n'y prépare pas plus que la mort brutale. Elle laisse tout au plus le temps d'ajuster son comportement. Mais cela soulève quelques questions: est-ce une bonne chose? Cela permet-il de rester soi, vrai, et de partir comme on était plutôt que comme l'on voudrait être?
Mais le thème principal du film reste le deuil, en l'occurrence, celui d'Oliver. C'est lui qui ouvre le film, et qui le clôt. Là aussi, il est filmé avec beaucoup de pudeur. Il laisse en bouche l'amertume de la solitude, ce sentiment presqu'évanescent, léger, subtil, et surtout, permanent. Il illustre le désoeuvrement dans lequel plonge le deuil.
Or, l'arrivée d'Anna (Mélanie Laurent) dans le film, et dans le deuil d'Oliver est un tournant. Au début, c'est une bouffée d'air. Un élément nouveau. Très vite, les deux personnages s'attachent l'un à l'autre. Leur relation, faite de pitreries, est d'ailleurs très touchante, et lumineuse. Mais c'est là que vient la question d'Anna: puis-je compenser le vide laissé par ce deuil?
La situation est compliquée pour les deux. Pour l'endeuillé qui ne parvient à s'extirper de son deuil, et n'ose pas d'ailleurs le faire. Mais aussi pour "le tiers", impuissant, qui peine à trouver sa place.
Ce sera d'ailleurs la cause de la rupture des deux héros.
Jusqu'à ce qu'Oliver fasse enfin son deuil. C'est symbolisé par l'arrivée du flash-back au décès de son père. En effet, le retracement de l'acceptation de sa maladie par le père est parallèle au propre processus de deuil du fils. C'est alors que la place pour Anna se libère vraiment.
Beginners est réellement un joli film. Tout en charme et en pudeur, avec une délicatesse de l'image, des voix, de la musique, qui se perd dans le cinéma et dans la vie.
Libellés :
Beginners,
Cinéma,
Deuil,
Ewan McGregor,
Mélanie Laurent,
Mike Mills,
Mouvement
jeudi 24 février 2011
(Nixon) (Oliver Stone)
Eté 1974.
La vie politique américaine est en plein séisme. En effet, suite à la découverte du cambriolage du Watergate, QG du parti opposant, par des hommes de main de Richard Nixon, président des Etats-Unis aux moments des faits, et réelu à leur suite, l'Amérique entière, toujours marquée par l'assassinat de Kennedy, s'ébranle. La guerre du Vietnam, qui fait rage et jamais ne s'achève, sans victoire, sans défaite totale, commence à lasser Outre-Atlantique. La classe estudientine se fait d'ailleurs la voix de ce mouvement pacifiste auquel se greffe le milieu hippie. Richard Nixon est sommé de démissionner par la Commission d'enquête, qui d'un moment à l'autre le "renverra". Il refuse à plusieurs reprises, malgré la colère des citoyens.
Richard Nixon avait pourtant tout pour être l'emblème de l'American Dream. Fils d'un fermier pauvre et d'une mère très croyante, ce qu'il ne se lasse pas de répéter dans ses discours électoraux, il parvient à suivre des études de droit dans une petite université, et devient un avocat apprécié.
Cependant, il se lance dans le politique. Aux côtés de MacCarthy, dont il représente le courant apparemment plus modéré, il tente de dénoncer quelques scandales à l'heure où la peur du communiste envahit l'opinion publique.
Oliver Stone envisage d'ailleurs à demi-mots sa participation à des actions répressives illégales lors de l'épisode de la Baie des Cochons.
MacCarthy tombe, et Nixon perd sa place dorée dans le monde politique. Il se présente aux élections contre Kennedy, qui le dépasse de peu de voix au prorata. Là encore, il sombre dans l'oubli. Il revient à la fin des années 60, après la mort du frère de Kennedy, et cette fois, il est élu. La guerre du Vietnam est engagée, Nixon ne l'arrête pas. Il rend visite à Mao en Chine, acte hautement symbolique vers la trêve de la guerre froide. Puis le président de l'URSS est invité à Washington. Nixon s'implique, et est l'auteur de bonnes choses. Le scandale du Watergate, qui éclate lors de son deuxième mandat, dénoncé par deux journalistes Bernstein et Woodward du Washington Post, s'appuyant sur les révélations d'un certain "Gorge Profonde", annonce sa fin. Ses membres de cabinet démissionnent. Un grand procès télévisé oblige tous ceux qui auraient approché le président à parler. Certains mentent, mais d'autres avouent. Nixon, lui, réfute.
Oliver Stone a choisi de retracer le parcours de Nixon en s'axant sur les morts qui ont "permis" son ascension au pouvoir. Celles de ses frères, permettant à ses parents de payer ses études, celles des deux Kennedy. Le film est aussi axé sur la vision très Shakespearienne de la spirale de folie dans laquelle tombe Nixon. Ambitieux, jusqu'à en oublier les règles. Menteur, jusqu'à en oublier la vérité. Le Nixon de Stone ressemble beaucoup à un Macbeth moderne, homme intègre qui s'enferme dans une spirale sans fin et sans remords. Le leitmotiv de l'insomnie est ici aussi récurent. Les dernières minutes de Nixon dans le film, où il apparait comme miné par sa propre folie contrastent avec l'annonce publique, sobre, froide, de sa démission, le 9 Aout 1974. Mais surtout, Stone décide d'appuyer le rôle symbolique de pantin des présidents qui n'ont aucune réelle assise, dirigés sans en être conscients par la mafia, les riches influents, qui dépendent de la situation politique et n'hésitent pas à se la créer propice à leurs affaires. On notera par ailleurs le parti pris du réalisateur qui envisage que Kennedy ait été tué sur les ordres des milliardaires de Sud à qui aurait plus profité l'ascension de Nixon. De même qu'il sous-entend aussi certaines malhonnêtetés commises par Kennedy. On peut donc faire tomber un président, mais pas le Système. Pourtant, le Système gouverne le monde, et prend pour visage un président. Pour visage, mais aussi pour bouclier.
Stone dans son film, avance qu'Henry Kissinger, membre du cabinet de Nixon, aurait été Gorge Profonde.
La vérité n'a éclatée que début 2006. En réalité, Mark Felt, numéro 2 du FBI de l'époque, a dénoncé les écoute téléphoniques du Watergate aux journalistes du Washington Post.
Nixon, accusé de trahison, fut gracié par le président Ford.
La vie politique américaine est en plein séisme. En effet, suite à la découverte du cambriolage du Watergate, QG du parti opposant, par des hommes de main de Richard Nixon, président des Etats-Unis aux moments des faits, et réelu à leur suite, l'Amérique entière, toujours marquée par l'assassinat de Kennedy, s'ébranle. La guerre du Vietnam, qui fait rage et jamais ne s'achève, sans victoire, sans défaite totale, commence à lasser Outre-Atlantique. La classe estudientine se fait d'ailleurs la voix de ce mouvement pacifiste auquel se greffe le milieu hippie. Richard Nixon est sommé de démissionner par la Commission d'enquête, qui d'un moment à l'autre le "renverra". Il refuse à plusieurs reprises, malgré la colère des citoyens.
Richard Nixon avait pourtant tout pour être l'emblème de l'American Dream. Fils d'un fermier pauvre et d'une mère très croyante, ce qu'il ne se lasse pas de répéter dans ses discours électoraux, il parvient à suivre des études de droit dans une petite université, et devient un avocat apprécié.
Cependant, il se lance dans le politique. Aux côtés de MacCarthy, dont il représente le courant apparemment plus modéré, il tente de dénoncer quelques scandales à l'heure où la peur du communiste envahit l'opinion publique.
Oliver Stone envisage d'ailleurs à demi-mots sa participation à des actions répressives illégales lors de l'épisode de la Baie des Cochons.
MacCarthy tombe, et Nixon perd sa place dorée dans le monde politique. Il se présente aux élections contre Kennedy, qui le dépasse de peu de voix au prorata. Là encore, il sombre dans l'oubli. Il revient à la fin des années 60, après la mort du frère de Kennedy, et cette fois, il est élu. La guerre du Vietnam est engagée, Nixon ne l'arrête pas. Il rend visite à Mao en Chine, acte hautement symbolique vers la trêve de la guerre froide. Puis le président de l'URSS est invité à Washington. Nixon s'implique, et est l'auteur de bonnes choses. Le scandale du Watergate, qui éclate lors de son deuxième mandat, dénoncé par deux journalistes Bernstein et Woodward du Washington Post, s'appuyant sur les révélations d'un certain "Gorge Profonde", annonce sa fin. Ses membres de cabinet démissionnent. Un grand procès télévisé oblige tous ceux qui auraient approché le président à parler. Certains mentent, mais d'autres avouent. Nixon, lui, réfute.
Oliver Stone a choisi de retracer le parcours de Nixon en s'axant sur les morts qui ont "permis" son ascension au pouvoir. Celles de ses frères, permettant à ses parents de payer ses études, celles des deux Kennedy. Le film est aussi axé sur la vision très Shakespearienne de la spirale de folie dans laquelle tombe Nixon. Ambitieux, jusqu'à en oublier les règles. Menteur, jusqu'à en oublier la vérité. Le Nixon de Stone ressemble beaucoup à un Macbeth moderne, homme intègre qui s'enferme dans une spirale sans fin et sans remords. Le leitmotiv de l'insomnie est ici aussi récurent. Les dernières minutes de Nixon dans le film, où il apparait comme miné par sa propre folie contrastent avec l'annonce publique, sobre, froide, de sa démission, le 9 Aout 1974. Mais surtout, Stone décide d'appuyer le rôle symbolique de pantin des présidents qui n'ont aucune réelle assise, dirigés sans en être conscients par la mafia, les riches influents, qui dépendent de la situation politique et n'hésitent pas à se la créer propice à leurs affaires. On notera par ailleurs le parti pris du réalisateur qui envisage que Kennedy ait été tué sur les ordres des milliardaires de Sud à qui aurait plus profité l'ascension de Nixon. De même qu'il sous-entend aussi certaines malhonnêtetés commises par Kennedy. On peut donc faire tomber un président, mais pas le Système. Pourtant, le Système gouverne le monde, et prend pour visage un président. Pour visage, mais aussi pour bouclier.
Stone dans son film, avance qu'Henry Kissinger, membre du cabinet de Nixon, aurait été Gorge Profonde.
La vérité n'a éclatée que début 2006. En réalité, Mark Felt, numéro 2 du FBI de l'époque, a dénoncé les écoute téléphoniques du Watergate aux journalistes du Washington Post.
Nixon, accusé de trahison, fut gracié par le président Ford.
Inscription à :
Articles (Atom)















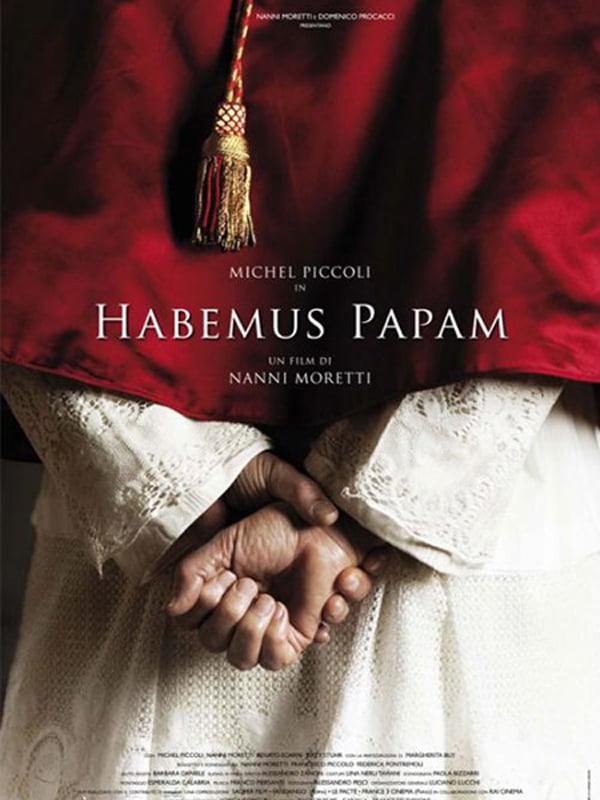


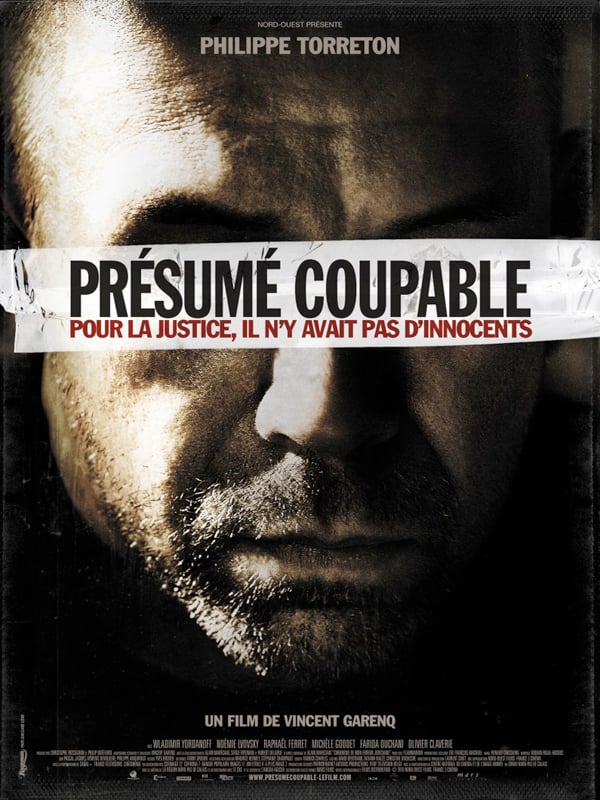




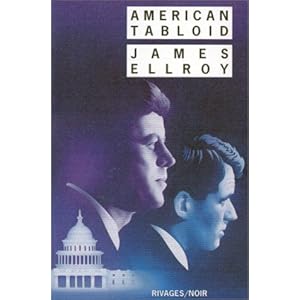





.jpg)

